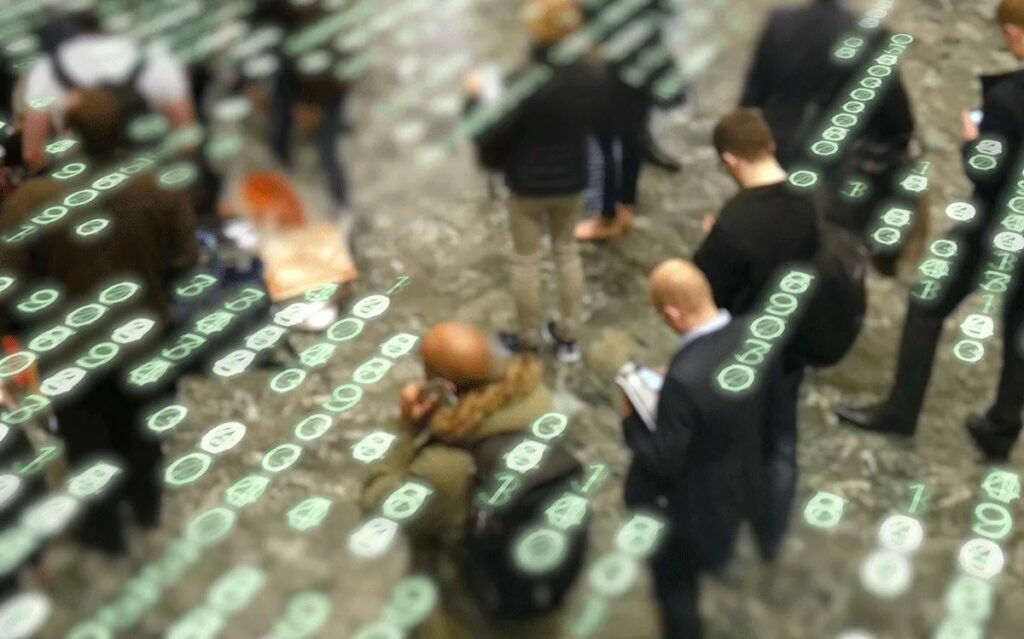Sonneur, saltimbanque, apothicaire, épicier, quincaillers-cloutiers, matelassier, forgeron, tonnelier, cocher, sténodactylographe… Tous ces métiers ont occupé des générations de travailleurs avant d’être relégués aux livres d’histoire par l’industrialisation. Aujourd’hui, les débats autour du chômage technologique sont à nouveau au cœur de l’actualité avec l’avènement de la quatrième révolution industrielle incarnée par l’intelligence artificielle et les machines connectées[1]. Sommes-nous donc à l’aube de la fin du travail tel qu’on l’a connu et pensé dans les discours, l’imaginaire collectif et le fonctionnement actuel de la société, c’est-à-dire de l’emploi de salariés et de petits indépendants[2] ? L’analyse anti-tech permet de contextualiser la course frénétique à l’IA dans une plus longue histoire de l’aliénation des peuples au système techno-industriel, où les travailleurs sont réduits en appendices remplaçables de machines toujours plus performantes et autonomes.
L’impact très concret du développement de l’IA
L’intelligence artificielle est une superpuissance de calcul qui permet d’automatiser des tâches répétitives ou, via l’analyse extrêmement rapide d’une quantité folle de données et d’informations, de générer des textes, des images ou des sons. C’est en cela qu’on peut craindre, à juste titre et parce que les entreprises l’annoncent ou le font déjà, des licenciements au profit de machines plus performantes et moins faillibles que les êtres humains, ces derniers étant exposés aux blessures, aux accidents, aux burn-out, etc.
Une vive inquiétude traverse ainsi telle une lame de fond toute la société depuis plusieurs années déjà. Elle fait parfois des saillies dans l’actualité, comme lors de la grève des scénaristes de Hollywood qui craignaient d’être remplacés par des IA.
Le fait est que chaque révolution industrielle s’est accompagnée d’un bouleversement du monde du travail[3]. Les entreprises, les multinationales et les États ont à chaque fois cherché à exploiter les nouvelles techniques et technologies pour gagner en productivité, et ceux qui ne l’ont pas fait ont disparu. Au cours des XIXe et XXe siècles, la quasi-totalité des emplois agricoles et artisanaux a disparu au profit du secteur secondaire avec l’industrialisation massive et l’exode rural. À partir des années 1970, on assiste à la tertiarisation du travail, c’est-à-dire, à l’explosion des métiers du service et non plus de la production, notamment due à l’ouverture des échanges mondiaux et aux délocalisations. La désindustrialisation, qui a causé tant de désarrois et de luttes sociales, n’a rien à voir avec une ingérence de la part des politiques ; ce bouleversement sociétal est dû à 65 % au progrès technique d’après un rapport de l’inspection générale des finances[4]. Or, à l’aube d’une nouvelle révolution industrielle avec l’IA, on peut se demander que deviendra l’écrasante majorité des personnes qui travaillent dans le tertiaire si des machines peuvent accomplir leurs tâches.
En fait, il est admis que nos économies dites « avancées » sont en perte de croissance de productivité depuis 2008. On envisage même que la croissance de l’offre de travail pourrait tomber à zéro entre 2030 et 2040. Les technocrates estiment donc qu’une productivité alimentée par la technologie serait la bienvenue[5], et attendent de l’IA qu’elle comble un trou d’air de la croissance par une nouvelle fuite en avant. Cette manœuvre a des conséquences écologiques et sociales d’ores et déjà dramatiques.
L’étude la plus importante sur l’IA et le chômage de masse a été réalisée il y a un peu plus d’un an. Selon cette étude, basée aux États-Unis, un quart des tâches professionnelles actuelles pourraient être automatisées[6]. Parmi les secteurs les plus exposés, on peut citer entre autres l’administratif, le juridique, le journalisme, avec les secrétaires de rédaction par exemple, le milieu du graphisme ou encore – paradoxalement – celui de la tech. En France, un rapport de 2018 stipule quant à lui que ce sont les postes d’ouvriers non qualifiés dans les industries de process, la manutention, le second œuvre du bâtiment, la mécanique, les agents d’entretien et les caissiers qui seront les premiers à se voir remplacés par des machines[7].
Ces études permettent de distinguer le remplacement, c’est-à-dire la disparition totale des emplois, du « complément », où seulement une partie des tâches des salariés sont automatisées. Un tel scénario laisse aussi entrevoir de nombreux problèmes : diminution de salaire, du temps de travail menant par exemple au cumul d’emplois, nouvelles méthodes d’exploitation des travailleurs en les obligeant à faire de nouvelles tâches de manière plus ou moins informelle, etc. Avec l’obligation de « monter en compétences » pour garder son travail induite par l’imposition de nouvelles technologies, les patrons imposeront des formations et des adaptations pour prendre en main ces outils. Mais de la même manière qu’avec la pénétration du numérique dans le monde du travail, de nombreuses personnes seront laissées sur le carreau, ce qui ne fera qu’exacerber les tensions et les inégalités. En tout, 70 % des emplois pourraient être remplacés ou modifiés en profondeur par l’IA. Aux États-Unis et en Europe, 300 000 millions de postes sont exposés à l’automatisation par l’IA[8].
L’IA va conduire à une transformation violente du monde du travail et cela est logique : le but de l’IA est d’automatiser des actions humaines. Sa raison d’être est donc la suppression d’emplois. Face à cela, les travailleurs et les syndicats sont en difficulté en raison de la complexité de ces technologies, et de l’intrication toujours plus opaque des acteurs impliqués dans leur développement.
Une mutation profonde du monde du travail malgré les discours rassurants des technocrates
Les technocrates, comme c’est bien connu, sont soucieux du sort des masses et concernés par les conséquences de la pénétration des technologies qu’ils développent dans la société. Ils tentent ainsi de rassurer les travailleurs : le remplacement des salariés par des machines sera accompagné d’un déplacement des emplois, de plans sociaux et le développement de l’IA donnera lieu à une réindustrialisation prospère pour tous.
Or il s’avère déjà qu’une grande partie des emplois créés par l’IA seront des emplois d’ingénieurs extrêmement qualifiés[9]. Cela va drastiquement renforcer les inégalités scolaires au détriment des personnes moins à l’aise avec les mathématiques, ou tout simplement celles ne parvenant pas à s’adapter au cadre ultra coercitif et normalisateur du système scolaire.
N’oublions pas, par ailleurs, que nous sommes tous déjà mis au travail par les entreprises d’IA : nous alimentons gratuitement les réseaux sociaux de nos données et de contenus plus ou moins créatifs, nous produisons des flux d’informations sur nos smartphones qui nourrissent et améliorent les logiciels d’IA. Il existe par ailleurs ce que le sociologue Antonio Casilli appelle le digital labor : des microtravailleurs précaires et des testeurs de chatbots qui « propulsent la viralité des marques, filtrent les images pornographiques et violentes ou saisissent à la chaîne des fragments de textes pour faire fonctionner des logiciels de traduction automatique[10]. »
Nous pourrions aussi penser que l’intelligence artificielle donnera lieu à une réindustrialisation prodigue en emploi dans le secondaire. En effet, tandis que les GAFAM et les médias entretiennent par divers procédés malhonnêtes l’illusion d’une empreinte environnementale minime du numérique et de l’IA, allant jusqu’à parler de dématérialisation[11], il est crucial de rappeler que pour faire fonctionner les systèmes d’IA, il faut des mines de métaux rares, des usines pour traiter et transformer ces matières premières, et des infrastructures de stockage et de transport de données. Ces secteurs-là demandent de la main-d’œuvre, mais il ne faut pas oublier que les plupart des mines sont exploitées dans d’autres pays, où les réglementations de sécurité et le Code du travail sont plus flexibles et permettent d’obliger des gens à manipuler des substances ultra-toxiques et à dévaster des écosystèmes sans rendre de compte. Ce sont donc des emplois précaires exercés dans des conditions délétères pour les travailleurs et l’environnement. Dans les pays dits « favorisés », chaque nouveau projet donne lieu à de vives et légitimes contestations en raison des destructions qu’ils entraînent. Les logiciels d’IA, qui consomment des quantités phénoménales d’eau et d’énergie, donneront lieu à des rationnements d’eau et d’électricité qui accentueront d’autant plus les tensions. Est-il souhaitable que des travailleurs dépendent d’un secteur ultra-polluant, ce qui rendra les luttes écologiques et sociales toujours plus difficiles à concilier ?
En outre, n’oublions pas que l’IA a d’ores et déjà des impacts concrets extrêmement négatifs sur le monde du travail : à l’embauche, déjà, où l’on peut rappeler le scandale de ces logiciels d’IA qui rejettent des candidatures sur des critères d’origines, de sexe, d’âge ou de handicap, l’IA accentuant les discriminations et outrepassant les réglementations sur l’égalité au travail[12].
Évoquons aussi ces logiciels de surveillance algorithmiques permettant d’observer et d’analyser les salariés : le contrôle des patrons, de la même manière que celui de la police et de l’État dans les rues, se renforce de manière exponentielle avec l’intelligence artificielle[13].
On en arrive au modèle dystopique des data driven manufacture, usines dans lesquelles
« des capteurs sont posés sur l’ensemble de la chaîne industrielle, des unités de conception à celles de production et de logistique, générant des masses de données traitées par des machines capables d’interpréter en temps réel quantités de situations et de dicter aussitôt à certaines catégories du personnel les actions à entreprendre. […] Ces techniques furent notamment expérimentées dans les entrepôts d’Amazon au sein desquels les manutentionnaires se voient adresser leurs instructions via des casques audio émanant de systèmes informatiques leur indiquant indéfiniment quel produit aller récupérer dans tel rayon, avant de le déposer mécaniquement dans tel contenant[14]. »
Ce genre de technologie dépolitise le travail et entrave toujours plus la contestation sociale en invisibilisant la mainmise du patronat et des technocrates sur les travailleurs.
Ne nous laissons pas non plus berner par le paradis terrestre que vendent certains techno-utopistes : l’automatisation du travail par l’IA ne délivrera pas les humains des nécessités terrestres pour laisser libre cours à la créativité de tous et généraliser l’oisiveté : même si certains arrivent à se libérer du temps grâce à l’automatisation, celui-ci sera à coup sûr exploité par l’industrie du loisir[15]. De plus, l’anthropologie nous enseigne que le confort matériel progresse toujours grâce à l’accroissement des inégalités.
Ces quelques exemples montrent bien qu’aucune strate de la société ne sera épargnée par le déploiement des logiciels d’IA. Au-delà d’une fin du travail plus ou moins fantasmée et d’un chômage technologique de masse, c’est bien une transformation en profondeur du monde du travail qui découlera de cette nouvelle révolution industrielle, où les êtres humains seront toujours plus aliénés, superflus, et contrôlés ; à la merci des technocrates qui développent ces technologies.
L’IA, une nouvelle étape dans la réalisation du fantasme de délivrance technoscientifique
Il est fondamental de toujours rappeler que les recherches en intelligence artificielle ne sont pas neutres ; il s’agit bel et bien d’une quête de pouvoir et de puissance de la part des institutions et des entités qui les financent. L’intelligence artificielle hérite donc de deux idéologies : la volonté de contrôler les populations des États-nations modernes, et le fétichisme technologique des industriels technocrates. Ainsi, même si les exploits de certains logiciels d’IA peuvent paraître effrayants et suscité une admiration craintive, il faut se rappeler que ces technologies s’inscrivent dans un processus historique en marche depuis longtemps, et au sein duquel elles ne représentent qu’une étape. La finalité : se passer entièrement des travailleurs, en déléguant l’intégralité de la production à des machines parfaites, afin de libérer le capitalisme industriel de la contestation sociale.
En 1824, Henri de Saint-Simon fonde une « religion » industrialiste, fondée sur la croyance en une gestion parfaite et vertueuse de la société et du monde vivant par la technique. Après la seconde Guerre mondiale, traumatisé par les atrocités dont il a été témoin (et auxquelles il a activement participé en travaillant pour l’aviation et l’armée américaines), Norbert Wiener développe le mouvement cybernéticien. Émergeant dans les années cinquante, son but est de « donner une vision unifiée des domaines naissants de l’automatique, de l’électronique et de la théorie mathématique de l’information, en tant que « théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l’animal que dans la machine » ». La cybernétique
« fait germer dans les consciences l’idée selon laquelle les machines de calcul pouvaient dépasser leurs fonctions classiques et légitimes de classement, d’indexation, et de manipulation aisée de l’information quantitative pour celle illégitime de substitut aux décisions humaines qualitatives. Cette idée fait le terreau actuel des recherches surfinancées de l’intelligence artificielle depuis le début des années 2000 […][16] ». Les recherches en IA apparaissent donc ici, non pas comme une rupture, mais comme s’inscrivant dans la continuité d’une longue histoire. Dans ses liens avec l’industrialisme et la cybernétique, l’IA donne lieu à « un management algorithmique injonctif, cherchant l’efficacité maximale dans son paramétrage conceptuel[17]. »
Cette brève parenthèse historique permet de remettre vivement en question le mythe de délivrance technoscientifique tel qu’il a été défini par Aurélien Berlan[18] ; l’histoire de la prolétarisation et de la destruction de l’environnement ne peut définitivement plus être dissociée de celle du progrès technique et de l’industrialisation. Si, encore une fois, on nous ressert avec l’IA l’argumentaire fallacieux de la délivrance des tâches pénibles et répétitives par les machines, en faisant miroiter une « diversification » des métiers, comme si l’IA allait rendre plus intéressants les emplois, il est crucial de ne pas se laisser berner par ces discours. L’objectif ultime de l’IA, et ce, malgré tous les plans sociaux et les réglementations qui pourront être concédées par les États et les patrons, est bien de rendre l’humain superflu, caractéristique identifiée par Hannah Arendt comme inhérente aux systèmes totalitaires[19].
Chaque révolution industrielle, chaque vague d’innovations techniques ont donné lieu à des critiques, des contestations et des révoltes[20]. L’IA, malgré les discours rassurants des technocrates, doit elle aussi être rejetée, pour toutes les raisons évoquées jusqu’ici, qui ne sont par ailleurs pas exhaustives. Comme nous le rappelle Sebastian Cortès : « L’informatique est un piège redoutable qui confère une apparente liberté pour mieux nous enfermer. La forme autoritaire et hiérarchique, pyramidale et paternaliste du capitalisme industriel a évolué, mais est toujours là, sous un vernis cool, jeune, moderne. Taylorisme et fordisme n’ont pas disparu, mais ont pris des formes inédites : l’informatique, concrétisée dans l’ordinateur, est leur nouveau support physique, le numérique leur nouvelle technologie, Internet leur nouveau réseau, mais le travail est toujours leur première application concrète.[21] » Remettre en question l’impact de l’intelligence artificielle revient à critiquer l’impact du progrès technique sur le travail et le capitalisme industriel dans son entièreté :
« Il s’agit donc bien de critiquer, en même temps que la technologie numérique, la société qui va avec, et toute la société, parce qu’elle est aujourd’hui entièrement sous l’influence de cette technologie – et vice-versa. Numérique et néolibéralisme vont de pair : y aurait-il eu délocalisations massives d’usines s’il n’y avait eu informatisation des échanges commerciaux boursiers ? Indemnisations chômage de plus en plus difficiles d’accès et smic pour tous sans cotisations patronales vont avec l’immense popularisation du statut d’auto-entrepreneur et l’atomisation rampante de chacun derrière son écran. C’est exactement la même logique capitaliste à l’œuvre. La technologie numérique ne fait pas bande à part. Moins de droits collectifs et plus d’apparentes possibilités individuelles : chacun pour soi, et tous dans le mur[22] ! »
Le déploiement de l’IA dans le monde du travail et les inquiétudes légitimes qu’il génère sont l’occasion de rappeler les nuisances inhérentes au capitalisme industriel, l’impasse que représentent la réglementation et le réformisme, et la nécessité d’une révolution anti-tech afin de couper l’herbe sous le pied à de nouvelles formes toujours plus totalitaires et écologiquement insoutenables d’exploitation.
N.M.
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/01/26/un-monde-sans-travail-quand-le-chomage-technologique-arrivera_6159363_1698637.html ↑
Vanhaele, Thibault. Analyse de l’influence des nouvelles technologies pour l’emploi / le travail : recherche
économique et philosophique. Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication,
Université catholique de Louvain, 2017. Prom. : Van Haeperen, Béatrice ; Hunyadi, Mark. http://
hdl.handle.net/2078.1/thesis:8934, p. 57. ↑
https://www.lebigdata.fr/enquete-ia-impact-emploi ↑
https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/Rapports%20de%20mission/2022/2022-M-015-04_Rapport_Services_industriels.pdf, p. 3 ↑
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/795593/chronique-l-intelligence-artificielle-et-son-chomage-technologique? ↑
Ibid. ↑
Cédric Villani, Marc Schoenauer, Yann Bonnet, Charly Berthet, Anne-Charlotte Cornut, et al.. Donner un sens à l’intelligence artificielle : Pour une stratégie nationale et européenne. Mission Villani sur l’intelligence artificielle, 2018, Yann Bonnet, Secrétaire général du Conseil national du numérique, 978-2-11-145708-9. ⟨hal-01967551⟩, p. 103. ↑
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ia-generative-pourrait-menacer-300-millions-d-emplois-90000.html ↑
https://www.weforum.org/agenda/2023/05/jobs-lost-created-ai-gpt/ ↑
Caselli, Antonio. En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Le Seuil, 2019. ↑
Izoard, Célia, Berlan, Aurélien. « Dématérialisation. Le monde numérique est-il un paradis virtuel ou un bagne industriel ? » dans : Berlan, Aurélien, Carbou, Guillaume et Teulières, Laure (dir.) Greenwahsing. Manuel pour dépolluer le débat public, Paris, Editions du Seuil, 2022, pp. 85-93. ↑
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/discrimination-recrutement-logiciel-intelligence-artificielle/ ↑
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/354088/Les-entreprises-comme-Walmart-et-Delta-utilisent-l-IA-pour-surveiller-en-temps-reel-les-messages-des-employes-sur-les-applications-de-collaboration-afin-de-controler-le-sentiment-et-la-toxicite/
https://www.noovo.info/nouvelle/les-employes-sont-de-plus-en-plus-surveilles-en-raison-de-lintelligence-artificielle.html ↑Guerber, Arthur. La fabrique du progrès. Scientisme, système technicien et capitalisme vert, Lyon, Atelier de création libertaire, 2022, pp. 193-194. ↑
Cortés, Sebastián. Antifascisme radical ? Sur la nature industrielle du fascisme, Paris, Editions CNT-RP, 2015, p. 92. ↑
Guerber, A. La fabrique du progrès, op.cit, pp. 221-222. L’auteur s’appuie sur les écrits d’Eric Sadin (L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un antihumanisme radical, Paris, L’Échappée, 2018 et La siliconisation du monde. L’irrésistible expansion du libéralisme numérique, Paris, L’Échappée, 2016) pour dresser une synthèse des implications sociales et environnementales de la numérisation aux pages 192-217. ↑
Guerber, A. La fabrique du progrès, op. cit., p. 196. ↑
Berlan, Aurélien. Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, St-Michel-de-Vax, La Lenteur, pp. 104-110. ↑
Pollmann, Christopher. Le totalitarisme informatique, Bordeaux, Le bord de l’eau, coll. « Alterrité critique », 2024, ↑
Jarrige, François. Technocritiques. Du refus de la machine à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, 2016, 434 p. ↑
Cortés, Sebastián. Antifascisme radical, op. cit., p. 85. ↑
Cortés, Sebastián. Antifascisme radical, op. cit., pp. 75-76. ↑